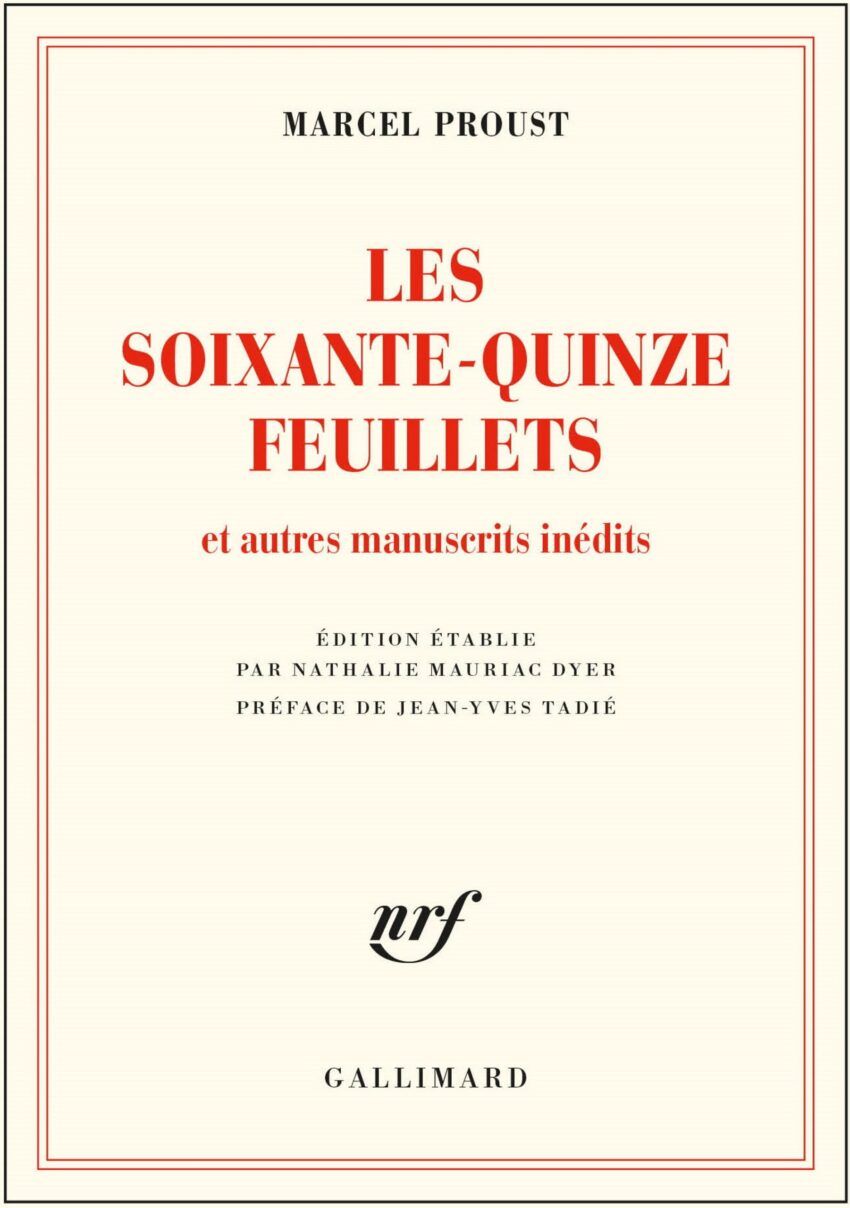
Les soixante-quinze feuillets et autres manuscrits inèdits, Marcel Proust
Leçon de littérature
La première chose que nous nous demanderons, plus que probablement, devant Les soixante-quinze feuillets. Et autres manuscrits inédits, c’est : qu’est-ce qui doit nous amener à les lire ? pour quelle raison sommes-nous censés nous intéresser à ces écrits inédits du grand Marcel Proust qui, comme nous le dit l’éditeur, Gallimard, “étaient devenus légendaires”.
 Légendaires, bien sûr, pour les proustiens. Pour tous ces amoureux de La recherche qui ne cessent (jamais) de chercher (nouvelles) occasions d’apprécier la prose (captivante) de l’écrivain français. Pour tous ceux pour qui la recherche archéologique sur les racines et les fondements de son œuvre majeure devient non seulement une joie mais aussi — aussi et en même temps ; en même temps et aussi — une passion, une justification en soi.
Légendaires, bien sûr, pour les proustiens. Pour tous ces amoureux de La recherche qui ne cessent (jamais) de chercher (nouvelles) occasions d’apprécier la prose (captivante) de l’écrivain français. Pour tous ceux pour qui la recherche archéologique sur les racines et les fondements de son œuvre majeure devient non seulement une joie mais aussi — aussi et en même temps ; en même temps et aussi — une passion, une justification en soi.
Le problème est que ceux sont — nous sommes : je m’y compte — proportionnellement peu nombreux. Nous sommes une minorité au sein d’une minorité. Nous sommes les happy few stendhaliens.
Et le reste, alors ? Et les autres, pourquoi seraient-ils intéressés par la lecture de ces manuscrits ? Ou, plus précisément : seraient-ils/pourraient-ils être intéressés à les lire ?
Ma réponse
Ma réponse ne peut pas être plus simple ni plus claire : bien sûr oui, ils devraient être intéressés à les lire.
Non pas — du moins, non pas uniquement — parce que ces soixante-quinze feuillets font partie de la première genèse d’À la recherche du temps perdu, parce qu’ils deviennent une pièce maîtresse pour comprendre la préhistoire de cette œuvre clef de la littérature du XXe siècle, pour savoir d’où elle est venue et comment elle a évolué, mais aussi et surtout parce qu’ils sont une source permanente de jouissance littéraire, car la prose proustienne fait amoureux à chaque page ; car le lire implique de se rendre compte que, sous cet aspect, il y a très peu d’auteurs qui puissent lui être comparés.
Il y en a peut-être quelques-uns, comptés sur les doigts d’une main, qui peuvent s’en approcher — parmi eux, une autre maîtresse de la langue : Virginia Woolf —, qui sont capables de nous offrir un plaisir littéraire ou artistique, plastique, similaire.
Mais lorsqu’il s’agit d’ajouter à cette jouissance ou à ce plaisir une profondeur psychologique ou analytique, lorsqu’il s’agit d’utiliser la magie du langage pour peindre à travers lui l’âme ou la condition humaine, lorsqu’il s’agit de dissoudre la beauté et la profondeur, Proust, s’il ne reste tout seul, du moins pratiquement seul.
La grandeur des détails
Le manuscrit commence par une très belle description d’un moment : « On avait rentré les précieux fauteuils d’osier sous la vérandah car il commençait à tomber quelques gouttes de pluie et mes parents après avoir lutté une seconde sur les chaises de fer étaient revenus s’asseoir à l’abri », mais ce qui, à mon avis, lui donne une force énorme, ce qui le rend inoubliable, ce sont ces petits détails sur lesquels le narrateur se concentre pour nous donner, d’un coup de pinceau qui peut paraître à première vue anecdotique, l’image et la force des personnages.
De ces personnages qui, précisément grâce à ces détails, deviennent des personnes, obtiennent un grand relief, sont remplis non seulement de personnalité, mais, ce qui est encore plus important, de vie, de réalité. Pour essayer de l’exprimer avec plus de précision, d’authenticité, de vérité.
Une vérité sans doute étroitement liée à la différence, à ce qui rend les personnages uniques ; à ce qui, en les distinguant des autres, leur permet d’être ce qu’ils sont, leur permet d’être eux-mêmes.
Ainsi, pendant que « mes parents […] étaient revenus s’asseoir à l’abri […] [,] ma grand-mère […] continuait sa promenade rapide et solitaire dans les allées parce qu’elle trouvait qu’on est à la campagne pour être à l’air et que c’est une pitié de ne pas en profiter ».
Car les autres, dès qu’ils sentaient la pluie, couraient déjà à l’abri, à la maison pour éviter le désagrément ; par contre, la grand-mère n’acceptait pas cette limitation, mais préférait continuer à profiter du contact avec la nature, de l’air libre : « La tête levée, la bouche aspirant le vent qui soufflait et qui lui faisait dire qu’“ enfin on respirait ” ».
De cette nature qu’elle ne pouvait pas apprécier lorsqu’elle était fermée chez elle, qu’elle ne pouvait pas aussi non plus apprécier lorsqu’elle n’était pas à la campagne.

Non expliquer, exprimer
Tout cela, les grands auteurs classiques (étant considérés comme tels tous ceux avant l’énorme saut qualitatif du XXe siècle), non seulement nous l’auraient expliqué, mais l’auraient fait prolixement, avec tout détail. L’auraient fait en recourant, si nécessaire, à un long voyage à travers les racines biographiques du personnage. Si nécessaire, en effectuant un long voyage à travers les racines biographiques du personnage.
Nous expliquant non seulement sa vie, mais celle de ses prédécesseurs. Nous expliquant d’où il vient, quelles étaient ses racines familiales et son enfance, afin que nous puissions savoir d’où il vient et donc qui il est, pourquoi il agit comme il le fait.
La littérature du XXe siècle, et Proust comme l’un de ses plus grands représentants, n’agit pas de cette manière : elle n’explique pas, mais exprime.
Elle s’affranchit de l’arbre généalogique et nous présente ses personnages dans l’instant même, à travers leurs actions, à travers leur manière de faire, de penser ou de réagir. Il ne nous explique ni ne nous dit pas ce qu’il fait ou ce qu’il pense — et encore moins nous informe des raisons qui les poussent à agir comme ils le font — mais il nous montre ce qu’ils font, ce qu’ils pensent et comment ils réagissent.
Sans nous le dire, ou du moins en nous en disant très peu, le moins possible, il nous en dit bien plus qu’une longue explication ne pourrait le faire : la grand-mère ne laisse pas que ce soit le temps — une circonstance extérieure ; aucune circonstance extérieure, en fait — qui décide à sa place quoi faire ou ne pas faire.
Sans nous l’avoir dit, donc, au moyen d’une rapide pincée ou d’une annotation qui paraît peu, presque insignifiante, il nous en a dit plus sur le caractère de la grand-mère que d’autres auteurs en des milliers de mots.
Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais de cette façon, l’image de la grand-mère est, inconsciemment, marquée — et qui dit « marquée », dit connotée : la connotation de liberté de la grand-mère nous accompagnera à chaque fois qu’elle fera son apparition.
Du particulier à l’universel
N’importe quel autre auteur — du moins, évitons autant que possible d’être catégorique, l’immense majorité des auteurs — aurait sûrement été plus que satisfait de ce succès ; avec cette annotation qui lui a permis de doter son personnage d’une personnalité incontestable et incomparable ; avec cette note — prise comme au naturel, comme décrivant l’un des nombreux événements qui se produisent tout au long de la journée — qui nous permettra non seulement d’identifier la grand-mère dès qu’elle tourne le nez sur de nouvelles pages, mais de prédire comment elle agira.
Non, à l’auteur de Contre Sainte-Beuve il lui faut aller plus loin. Il lui faut faire le saut — plus que le saut, sans doute, le lien — entre le particulier et l’universel.
Et il lui faut le faire de la manière la plus difficile mais aussi la plus riche : parvenant à ce qui est particulier — à ce qui doit nous permettre d’identifier, sans possibilité d’erreur, le caractère de la grand-mère ; ce(s) trait(s) distinctif(s) et unique(s) qui devrai(en)t nous permettre de savoir que c’est d’elle et seulement d’elle dont on parle ou dont on parle — devienne, en même temps, universel.
Ou qu’est-ce qui revient au fait que, même dans son individualité — je dirais même plus : précisément en raison de son individualité — son caractère est universel ou universable.
Que, pour reprendre les termes de John Donne, “no man is an island”.
Ou, pour essayer de le dire avec plus d’exactitude, que tous les hommes sommes des îles (nous sommes uniques dans notre manière d’être) mais notre île, aussi séparée ou lointaine soit-elle, n’est pas qu’un morceau du continent de l’humanité (“No man is an island,/ Entire of itself;/ Every man is a piece of the continent,/ A part of the main”), mais que chaque île a des îles sœurs.
Ainsi, continuant à faire référence à sa « grand-mère », il nous raconte que : « bien qu’elle n’eût fait que quelques pas et que les allées n’eussent pas eu le temps d’être encore bien détrempées elle avait horriblement crotté sa jupe prune”, un fait qui la rend en principe individuelle, mais qui la fait partie de l’humanité dès qu’il y ajoute : “car il est à remarquer que les jambes des personnes qui sont douées d’une imagination ardente, d’un esprit élevé et sans contrepoids d’amour-propre, ne cessent pas un instant, tandis qu’elles se promènent en agitant mille pensées, de ramasser toute la boue des chemins et même semble-t-il plus encore, de la faire remonter rapidement le long des jupes, de la frotter de manière à l’étaler convenablement sur une assez large étendue et d’en éclabousser les parties de la robe ou du pantalon trop éloignées pour être gagnées directement par l’alluvion”.
Mercredi, 17 d’avril del mmxxiv
© Xavier Serrahima 2024
www.racodelaparaula.cat
www.xavierserrahima.cat
@Xavierserrahima
 orcid.org/0000-0003-3528-4499
orcid.org/0000-0003-3528-4499
Veure la llista completa d’autors i autores i títols analitzats
Veure la llista completa de traductors i traductores de les obres analitzades
![]() Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)













