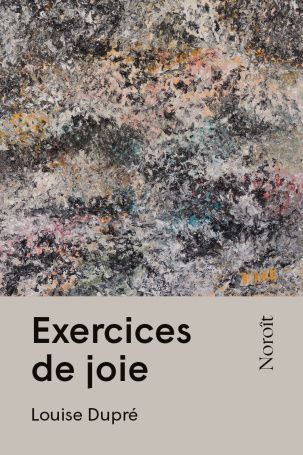
Exercices de joie (III), Louise Dupré
Entendre
Pour ce troisième compte rendu d’Exercices de joie de Louise Dupré (Éditions du Noroît / Éditions Bruno Doucey, 2022), je me pencherai sur la dernière suite poétique de la première partie, des pages 41 à 50, suite poétique qui commence par un exergue très appropriée de Geneviève Amyot : « plus que jamais nos corps/ doivent s’ouvrir ».
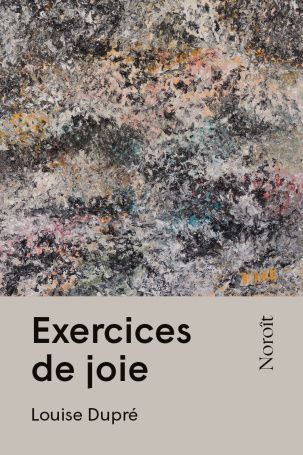 Très appropriée parce que, pour l’autrice québécoise, c’est maintenant — pour essayer de le dire avec plus de précision, c’est aujourd’hui, avant qu’il ne soit trop tard ; avant que le soir n’ait laissé place à la nuit — que « nos corps/ doivent s’ouvrir », nos corps et, surtout, notre âme.
Très appropriée parce que, pour l’autrice québécoise, c’est maintenant — pour essayer de le dire avec plus de précision, c’est aujourd’hui, avant qu’il ne soit trop tard ; avant que le soir n’ait laissé place à la nuit — que « nos corps/ doivent s’ouvrir », nos corps et, surtout, notre âme.
Parce que c’est maintenant, « plus que jamais », quand « le soir, il ne reste de toi qu’une cage calcinée où aucun oiseau ne voudrait se réfugier », (p. 42), quand « tu as peur de mal mourir » et, ce qui est encore pire, quand « tu as peur de survivre », qu’il te faut t’ouvrir au monde, essayer de transformer tes doutes en mots : « Le lait maigre des mots, tu essaies de le transformer en corne d’abondance », (p. 41).
Trop tard
Demain, ce serait peut-être tard, trop tard. Demain, ce ne serait peut-être plus le temps de « donner un sens à la joie ». Et c’est maintenant « que tu penses […] à la félicité », que tu peux y penser.
C’est maintenant que tu te demandes s’il « te reste assez de pas pour marcher à la joie » ; que tu te demandes «à quel moment précis les griffures de ta main s’effaceront sur la feuille ».
Bien que ce soit maintenant, que ce soit aujourd’hui que « l’avenir se reflète déjà dans tes yeux », même s’« il te harcèle même quand tu baisses les paupières », même si « tu sens approcher le temps de l’aphasie », ce temps ou « personne ne pourrait te secourir », même si« tu perds la faim et la soif » et que « la détresse devient une habitude », même si « regarder te fait mal, entendre te fait mal », tu « poursuis ta marche », « tu poursuis ta marche ».
Tu la poursuis parce que, malgré toutes ces raisons, tous ces contretemps, malgré que (tu croies) qu’est arrivé le soir de la vie, que ce qui t’attend est l’hiver, si tu peux écrire ce que tu veux écrire, ce qu’il te faut écrire, « tu débusquer[as] l’hiver dans les mots ». Et « si tu […] arrivais, tu mourrais heureuse ».
Rédemption
 Cette écriture, ces exercices de joie sont, en vérité, une rédemption.
Cette écriture, ces exercices de joie sont, en vérité, une rédemption.
Dans ce livre de poèmes qui, comme nous le verrons, s’interroge, la narratrice se demande : « Rêverais-tu encore d’une rédemption ? ». Et, qu’elle le sache ou non, qu’elle en soit (plus ou moins) consciente, la réponse à sa question, c’est le livre. Ce livre qu’elle devait écrire.
Qu’elle devait écrire, nécessairement, non pour obtenir des réponses, et encore moins, toutes les réponses — l’art ne nous donne jamais de réponses ; ce que fait l’art, c’est clarifier (et multiplier) les questions —, mais pour (pouvoir) continuer à vivre, continuer à regarder vers l’avant : « et pourtant tu continues ».
Tu continues, tu ne cesseras jamais de continuer, tu ne te renonceras pas, parce que même si « tu ne crois plus aux miracles, […] tu aimes encore les films qui finissent bien ». Parce que « tu as si peu changé depuis l’enfance ». Parce que, malgré les soirs et la prochaine arrivée des hivers, tu conserves « ton éblouissement devant chaque prodige ».
Parce que même si les mots « n’ont rien à donner ni à recevoir […] tu écris […], tu t’obstines à écrire […] afin d’entendre bruisser le vert — tous les verts — des feuillages ».
C’est-à-dire, parce que, même lors de tes soirs et de tes hivers, ce que tu cherches, ce que tu veux chercher, ce que tu veux rédimer, c’est tout ce qui est vert, les lumières, l’éclairage, tout ce qui palpite encore.
Cette rédemption est, bien sûr, en même temps, une renaissance : « Tu voudrais recommencer depuis le début, comme si tu étais encore analphabète ».
Interrogation
Cette rédemption ou renaissance part d’une interrogation, d’un questionnement. Pour le dire peut-être plus précisément, de toute une suite d’interrogations : « tu poses des questions parce que tu ne trouves pas de réponses ».
C’est pour ça que, dans cette suite poétique de la première partie, il y a tellement de ‘comment’ : « Comment détacher… » ; « comment te fabriquer… » ; « Comment en arriver… », « Comment parvenir à… ».
La narratrice ne sait pas. Du moins, elle pense qu’elle ne sait pas. Elle pense qu’elle ne sait pas ce qu’elle devrait savoir. Elle craint de ne pas savoir, elle à peur de ne pas savoir. Au moins, de ne pas savoir ce qu’elle souhaiterait savoir : « Si au moins tu savais ce qui t’appartient »; « Tu ignores quand t’a abandonnée la langue de ta mère, tu ignores à quel moment tu as cessé d’en éprouver de la douleur ».
Et c’est pour ça qu’elle écrit, qu’elle a besoin d’écrire : pour essayer de savoir, pour essayer d’entendre. D’entendre et, en entendant, de s’entendre : « tu voudrais raconter l’enfance de tes images, même si tu ne les entends plus ».
Bien que la narratrice ne pense pas «que le poème est [s]on double. Il ne [l]’entend pas », le poème, les poèmes, ces exercices de joie ne lui sont pas seulement nécessaires — d’abord parce que « pendant [ces] quelques instants » qu’elle est en train de les écrire elle « oublie[…] la cruauté » — mais ils l’aident à essayer d’entendre le monde et à s’entendre.
Écrire aide la narratrice à « franchi[r] l’abîme qui […] sépare [son âme d’elle] » ; l’aide à « réintégre[r] [s]a chair », à « détacher l’une de [s]es côtes sans la fracturer », à se « fabriquer un autre corps ».

Les mots
C’est pour tout ça, c’est pour s’interroger, c’est pour essayer d’obtenir de (possibles) réponses qu’elle a besoin des mots. Mais non de grands mots — les grands mots, comme les grandes déclarations souvent ne nous aident pas, au contraire, souvent ils nous trahissent — , plutôt de petits mots.
Ces petits mots qui nous accompagnent la vie durant, à chaque jour, à chaque instant. Les seuls mots qui en réalité peuvent nous aider à dire, à entendre : « Tu as délaissé l’éloquence pour les phrases simples, les oraisons pour les prières sans dieux ».
Elle sait, depuis longtemps déjà, que c’est le petit qui est grand. Toujours, mais aujourd’hui encore plus que jamais, « tu te méfies des phrases qui pourraient écraser la lumière ». Et « tu aimes les livres disposés à faire silence ».
Elle sait que souvent, c’est le silence qui parle. Qui parle quand les mots ne peuvent dire. Qui parle au-delà des mots : « Tu respectes le silence des oiseaux. Il ne t’appartiendra jamais ». Et, pour essayer de savoir ou d’entendre : « Tu demandes sans demander, tu cries sans crier », « tu écris avec des stylos trouvés ».
« Il y a longtemps que tu as renoncé à faire corps avec la langue ». Et « tu te méfies des phrases qui pourraient écraser la lumière ».
C’est le petit qui est grand
Elle sait qu’il n’y a rien de facile dans la vie, qu’il est très difficile « donner un sens à la joie », mais que si elle veut le faire il n’y a, peut-être, qu’une façon, qu’un chemin : le faire peu à peu, à très petits pas, sans beaucoup demander, sans crier, en faisant des petites prières, des « prières sans dieux ».
Ou, ce qui est la même chose, en « pren[ant] ce qui t’est offert », même si c’est « petit », même si ce n’est qu’« un morceau ». En fait, surtout si c’est « petit », si ce n’est qu’« un morceau ».
Parce que, de la même façon que « tout est digne d’un livre », il n’y a rien de vraiment petit dans la vie, tout a son importance.
Rien n’est petit, tout est grand. Surtout pour elle qui « [n’a] jamais pensé grand, rêvé grand, imaginé grand ». Pour elle, qui, au soir de sa vie, quand elle sent l’hiver s’approcher, « aim[e] encore les fleurs pauvres, l’art pauvre, les gestes sans bravoure. Les chats perdus ».
Et c’est pour ça, parce que « [elle] ne souhait[e] pas un corps de gloire, juste une écorce assez dure pour [la] protéger », qu’elle fait ses exercices. C’est pour ça qu’elle « [s]e content[e] de penser joie en souriant ». Parce qu’elle« voi[t] encore petit ».
Qu’aujourd’hui n’est rien d’autre qu’une renaissance, n’est rien d’autre qu’une (toute nécessaire) rédemption : « tu as si peu changé depuis l’enfance ».
divendres, 12 de maig del mmxxiii
© Xavier Serrahima 2023
www.racodelaparaula.cat
www.xavierserrahima.cat
@Xavierserrahima
 orcid.org/0000-0003-3528-4499
orcid.org/0000-0003-3528-4499
Est-ce que tu veux lire les autres comptes rendus que j’ai écrits sur Exercices de joie, de Louise Dupré?
Veure la llista completa d’autors i autores i títols analitzats
Veure la llista completa de traductors i traductores de les obres analitzades
![]() Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)













