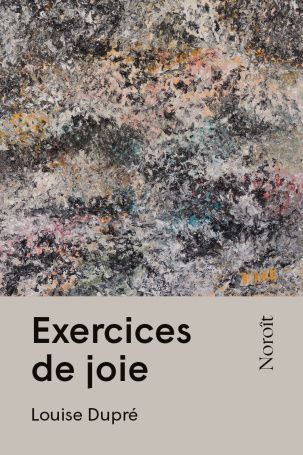
Exercices de joie (I), Louise Dupré
Faire face à la vie
Il (me) faut dire, en introduction, que Exercices de joie, de Louise Dupré, Éditions Noroît (Montréal)/ Éditions Bruno Doucey (Paris), 2022, est, à mon avis un grand, grand, grand livre de poèmes.
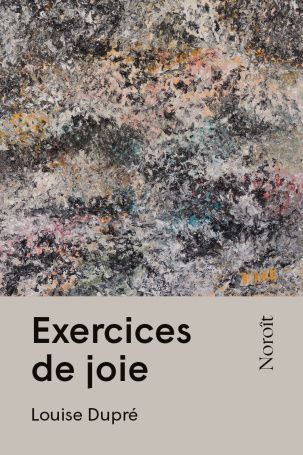 En fait, si j’étais un de ces critiques littéraires qui aiment les commentaires fracassants, les conclusions ou déclarations catégoriques, j’oserais dire que c’est un livre de poèmes extraordinaire. Mais, que ce soit pour une bonne ou une mauvais cause, je crois qu’il est préférable de ne pas employer, jamais, ces mots.
En fait, si j’étais un de ces critiques littéraires qui aiment les commentaires fracassants, les conclusions ou déclarations catégoriques, j’oserais dire que c’est un livre de poèmes extraordinaire. Mais, que ce soit pour une bonne ou une mauvais cause, je crois qu’il est préférable de ne pas employer, jamais, ces mots.
Ce qui est extraordinaire, en littérature — comme dans tout (autre) art —, on ne peut le voir qu’avec le temps ; qu’avec beaucoup de temps. Ce sera uniquement le temps qui donnera leur place aux œuvres, ce seront les siècles qui dicteront la / leur sentence. Maintenant, nous ne pouvons faire qu’une (simple) approximation.
Bien sûr, les lecteurs et lectrices qui ont lu les deux premiers recueils de ce triptyque poétique ne se surprendront pas quand je dis que ce dernier volume est un grand, grand livre. En tout cas, ils auraient été surpris si ce n’avait pas été le cas : Plus haut que les flammes et La main hantée ont remporté le Prix du Gouverneur général respectivement en 2010 et 2017.
Le plus naturel, le moins surprenant, est donc que ce dernier recueil du triptyque soit, au moins, à la hauteur des précédents.
Et, sans doute, comme je démontrerai modestement, il l’est.
L’unique surprise donc, ce à quoi aucun lecteur ou lectrice de l’écrivaine québécoise ne pouvait s’attendre, c’est le titre du livre : comment est-il possible qu’elle parle d’exercices de joie ?
Pour l’entendre, pour trouver sa justification, il lui suffira de le lire. De le lire avec les yeux bien ouverts ; avec l’âme bien ouverte.
Il (me) faut dire, aussi, que ce recueil n’est pas — pour le dire avec plus de précision : ce n’est pas seulement — un livre de poèmes, mais trois. Ou, pour (essayer d’)être plus précis encore : ce sont trois livres de poèmes qui composent un livre de poèmes plus volumineux. C’est, en même temps, un livre de poèmes et trois livres de poèmes.
Trois livres de poèmes qui sont les trois parties du livre.
Trois parties que je dois analyser partie par partie, je crois. Partie par partie, en premier lieu, pour pouvoir les analyser ensemble ensuite.
Premier livre
Le premier livre (ou première partie), pages 9 à 50, s’ouvre sur un long poème en vers.
Un très long poème en vers qui a, en exergue, une citation de Philippe Jaccottet fort appropriée : « Tant d’années, / et vraiment si maigre savoir, / cœur si défaillant ? ».
Appropriée parce que ce long poème — et, en fait, tout le livre — surgit précisément d’un cœur défaillant. Surgit, nécessairement, des « rêves noyés/ au fond de tes yeux », des « petits cadavres/ blanchis/ per les ans// qui te réveillent/ la nuit// quand tu voudrais dormir/ de tout ton sommeil ».
D’un cœur défaillant qui veut combattre sa défaillance. Qui veut — en fait, qui a besoin ; qui a un besoin urgent — de se libérer de tant de douleur, de tant de souffrance. Qui a besoin de se libérer de cette « fièvre/ sans remède », de cet acide/ qui gruge la raison » et qui « rend folle » la narratrice.
Et, ce qui est plus important, il le faut s’en libérer maintenant, aujourd’hui, alors que « tu comptes/ sur tes doigts/ les années qu’il te reste », alors que « tu es encore capable/ de respirer », que tu es « encore capable de remuer/ l’air étroit/des rues ».
Nécessité
Ces poèmes donc sont les fils de « ce qui parvient à surgir/ en soi ». Ils ont surgi non de la volonté, mais de la nécessité. Ont surgit, naturellement, non de la volonté d’écrire, mais de la nécessité d’écrire.
Ont surgi d’une nécessité actuelle. De maintenant, parce que « il est trop tard/ pour les regrets ». Parce qu’il est peut-être « trop tard/ pour rattraper le temps/ enfui », mais qu’il n’est pas trop tard pour essayer de trouver un moyen pour combattre la détresse et l’angoisse de la vie.
Il n’est trop tard mais, selon l’avis de la poète québécoise, c’est, peut-être, la dernière opportunité qu’il lui reste pour essayer.
Pour essayer de se débarrasser de tout ce qui la lestait tant. La lestait et la lassait tant. Pour essayer de « faire entendre/ les opéras du passé ».
Aujourd’hui
La dernière opportunité, c’est aujourd’hui, et non demain. Parce qu’il semble que demain, ce sera trop tard. Définitivement trop tard.
Parce que c’est aujourd’hui, parce que c’est maintenant qu’elle est « nue/ devant le miroir » ; parce que c’est aujourd’hui que « tu écoutes/ tranquille/ la mélodie du monde ». Plus exactement, qu’elle peut, finalement, l’écouter. Parce que jusqu’à présent, jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à maintenant, jusqu’à ce moment, elle ne pouvait pas l’écouter. Elle ne pouvait pas parce que les images étaient encore trop vives en elle. Parce que c’est seulement maintenant que « des images/ […] ne te blessent plus ».
Des images, certaines images, toutes ces images qui sont fixées, très (bien) fixées dans l’intérieur de la poète. Des images insurmontables, de douleur, qui hantaient son âme jusqu’à maintenant. Les images de Plus haut que les flammes et de La main hantée.
Ces images qu’elle craignait autrefois— qu’elle craignait, avec toute la raison — comme ne pouvant jamais s’effacer. Ces images qu’elle craignait qui l’accompagneraient jusqu’à ses derniers pas, jusqu’à la tombe.
Des images avec lesquelles vivre était un travail difficile, très difficile, chaque jour. Un travail difficile, insupportable, intolérable, chaque jour « où ton cœur/ [ne] cesse de cogner/ contre tes côtes ». Chaque jour où elle n’avait pas encore « une carapace [qui] te protège/ des cris/ que tu entends ».

Exercices de joie
Et c’est pour ça, parce que c’est maintenant qu’elle commence à tenir — au moins, à voir ; ou, tout juste, à entrevoir — « ces instants de grâce », qu’elle ressent le besoin d’écrire.
D’écrire ces exercices de joie qui sont, en fait, une tentative. Qui sont, en réalité, une recherche. La recherche d’un nouveau chemin. Peut-être, de son dernier chemin.
De ce dernier chemin qu’il lui faut — qu’il lui faut tant — pour combattre la douleur, pour combattre la peur, pour combattre la nuit qui, depuis tant d’années déjà, attaque son âme. L’attaque sans cesse.
Pour combattre « cette détresse/ impossible à soulager » qui « déchire ton oreille », qui « te tue ». Mais, et c’est encore pire, qui te tue « sans t’achever ». Et donc te fait devenir « une morte-vivante// contrainte à errer/ parmi un enfer/ de piétons ».
Mais comme, contrairement à hier, contrairement au passé, aujourd’hui, maintenant, « survire/ ne te suffit pas », il faut qu’elle réagisse. Mais comme ce qui lui suffisait jusqu’à présent a cessé de lui suffire, comme elle ne veut plus survivre mais vivre, re-vivre, il lui faut chercher un autre chemin. Plus précisément, il lui faut se frayer un chemin nouveau.
Le chemin « de minuscules joies/ arrachées à la détresse ». Minuscules, parce que seulement un peu, c’est tout. Joies, parce que « tu ignores/ comment nommer » cette nouvelle sensation, ce temps nouveau où, après la nuit — où, après tant de nuit — tu (entre)vois l’aube. Où, sinon l’aube, au moins, une certaine aube.
Et c’est pour ça que « tu chantes faux/ et mal et misère// mais tu chantes ».
Dire
Mais, pour atteindre cette certaine aube, pour (entre)voir « une petite clarté/ qui t’invite à la suivre/ dans le noir », pour « pouvoir/ ébranler les murs// érigés aux quatre coins/ de la honte », il lui faut dire : « tu apprivoises ton délire/ et tu écris ».
Elle écrit pour trouver dans la parole, dans l’écriture, la façon de dire, d’entendre et de s’entendre. Elle écrit de la poésie parce qu’elle a besoin de la parole pour explorer le monde ; pour explorer — plus exactement, pour essayer d’explorer — sa situation dans le monde, dans la vie.
Pour elle, la poésie, l’écriture, la littérature n’est pas un luxe, un privilège — même un don — , mais un besoin. Il lui faut le dire (l’exploration interrogative du dire) pour vivre.
Il lui faut le dire pour penser, pour réfléchir, pour voir. Pour penser mieux, pour réfléchir mieux, pour voir mieux.
Toujours et, avec plus de raisons (ou de besoin) encore, maintenant. Maintenant, alors que « tu n’as plus l’âge/ des roses et des oiseaux », alors que « tu lèves le regard/ vers l’espérance de l’aube// et tu l’accueilles/ dans ta paume ».
Alors qu’elle l’accueille dans sa paume par (dans et pour) l’écriture. L’écriture qui sert — plus précisément, qui peut servir ; qui essaie de servir — pour faire face à la vie.
Écrire
Et, pour faire face à la vie, à cette vie difficile, cette vie qui n’offre plus à la poète que quelques instants, très brefs, de repos, plus qu’un peu de lumière au milieu de la nuit — « il ne reste rien// sauf une petite clarté/ qui t’invite à la suivre/ dans le noir » —, il lui faut écrire.
Écrire parce que c’est uniquement à travers où grâce à l’écriture qu’elle peut se sauver : « comme si tu t’agrippais/ à une bouée ». C’est uniquement à travers (où grâce) à l’écriture qu’elle peut croire que les exercices de joie sont possibles.
Parce que seulement l’écriture (et le poème) « ressuscite ». Parce que seulement l’écriture « dépose des œillets/ sur le malheur// afin de le rendre/ supportable ».
Parce que l’écriture, « le poème est une prière/ secrète ». Une prière qu’il faut écrire avec simplicité, avec clarté, avec netteté : « écrire maigre/ écrire pauvre ».
Écrire petit à petit, avec sincérité, avec une sincérité absolue, avec (et du) cœur parce que la poète ne veut pas renier de ce qu’elle est. Parce que « plutôt que de renoncer/ à l’inquiétude/ du monde », elle fait le choix de «la souffrance ». Parce que « tu préfères ton tourment/ à la maladie/ des cœurs endurcis ».
Parce qu’elle ne peut pas se mentir (et donc se démentir) à elle-même. Parce qu’il lui faut se maintenir fidèle jusqu’à la fin. Et c’est pour ça que « tu apprivoises ton délire/ et tu écris// malgré la peur/ qu’on te coupe la main ».
Il lui faut écrire parce que (et ce vers, cette phrase est essentielle) « tu ne veux pas mourir/ avant la mort ». Parce, malgré tout, il reste beaucoup à vivre. Parce que la vie est devant.
Une vie qui est combat — qui continue à être combat —, mais qu’elle, « malgré [s]es côtes/ friables », malgré la persistance des douleurs, « veu[t] user/ jusqu’à la corde ».
Et pour ça, pour la faire revivre, pour la ressusciter, « tu reviens/ au verbe vouloir / tu le répètes/ comme s’il pouvait se montrer/ assez bienveillant// pour apaiser tes pleurs ».
dijous 23, divendres 24 i dissabte 25 de març del mmxxiii
© Xavier Serrahima 2023
www.racodelaparaula.cat
www.xavierserrahima.cat
@Xavierserrahima
 orcid.org/0000-0003-3528-4499
orcid.org/0000-0003-3528-4499
Est-ce que tu veux lire les autres comptes rendus que j’ai écrits sur Exercices de joie, de Louise Dupré?
Veure la llista completa d’autors i autores i títols analitzats
Veure la llista completa de traductors i traductores de les obres analitzades
![]() Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)













